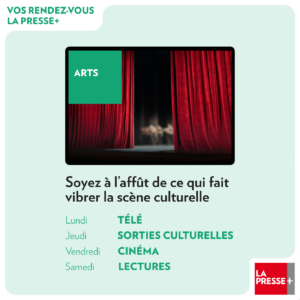Parlez-nous de la genèse du projet. Comment les ex-placé·e·s DPJ et leurs témoignages ont été un moteur artistique pour votre création ?
Comment la trame du cauchemar s’est-elle imposée dans votre création et de quelle façon la matérialisez-vous sur scène ?
Justement, en quoi est-ce un spectacle engagé, social et politique ?
Aviez-vous des idées préconçues ou des biais sur l’univers de la DPJ avant de plonger dans ce projet ?
Comment votre vision s’est-elle transformée ?
Et comment votre création résonne-t-elle avec l’actualité récente ?
Marie-Ève : Je me souviens que lors du premier atelier, un participant est entré avec son sac à dos, il sentait le weed. On a pensé, en bonnes premières de classe qui veulent faire un show sur la DPJ : « ah mon dieu, c’est sûr que lui, il ne restera pas, il n’aimera pas ça ! » Parfois, il était penché sur son cellulaire… en fait il était en train de nous écrire un slam ! Il avait été inspiré par une chose qu’on avait dite et il nous l’a fait lire après. Dans le groupe, certains ont un haut niveau de scolarité, d’autres beaucoup moins, et on arrive à avoir des conversations d’une profondeur impressionnante ! Il ne faut pas sous-estimer l’importance du bagage expérientiel. Est-ce que j’avais des biais au départ ? Oui. Ça m’a beaucoup appris sur la valeur de la vie, sur la notion d’entraide aussi. On dirait que ça a ancré ma pratique artistique et je sens que je vais m’engager davantage comme citoyenne. Quand j’ai entendu tout ce qui s’est dit dans les médias cet automne, par des professionnels, des sociologues, j’ai réalisé : « OK, tout ça est dans le show et il faut vraiment que ce soit entendu. On ne s’est pas trompées ! » Ça a validé beaucoup de choses, comme une confirmation de l’importance de ce spectacle.